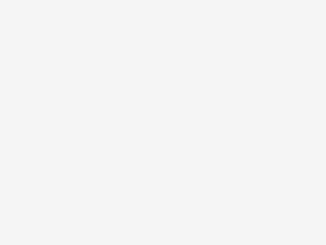IL FAUT LIRE CE TEXTE !
Il ne s’adresse pas seulement à l’intelligence d’un peuple, il parle directement au coeur des hommes. Si nous survivons – et NOUS SURVIVRONS -, il sera un jour étudié dans nos lycées et nos universités, comme un constat amer et un appel au sursaut salvateur face à l’engourdissement prélude à la mort annoncée d’une civilisation qui fut pourtant forte et brillante.
Avec une logique implacable, ciselée par une culture exceptionnelle, épicée parfois d’un humour glacial et désespéré, tout est dit ou presque sur la tragédie d’une Europe finissante, trahie et fracassée par ses prétendues élites avec la complicité plus ou moins passive de ses propres enfants.
« On n’arrête pas un fleuve avec les mains », écrivait Parménide. Par sa pensée, par ses écrits, par son courage, Renaud Camus s’efforce pourtant de contenir le tsunami qui tente de balayer notre culture millénaire.
Si tous les patriotes de France et d’Europe, « remplacés récalcitrants » héritiers des Lumières, finissent par se reconnaître et s’unir pour reprendre en mains leur destin confisqué par des lâches ou des traîtres, ce sera – entre autres – grâce à des hommes de la trempe de Renaud Camus qui leur auront montré le chemin.
Marc Le Stahler

![]()

La Fierté contre la repentance — tel est le titre, et le sujet, qui m’ont été donnés pour mon allocution ici. J’avoue en avoir été un peu désarçonné. Je ne suis certes pas homme à discuter l’autorité de notre ami Le Gallou, mais je dois reconnaître que je me suis demandé pourquoi j’avais été choisi pour traiter de ces questions-là. Ces mots-là ne sont pas vraiment de mon registre, croyais-je. Je parle plus volontiers d’honneur que de fierté, et plus de haine de soi, ou de sentiment de culpabilité, que de repentance. Cependant je suis tombé par hasard, plus ou moins, sur le point sept de la profession de foi du NON, l’un des deux mouvements que je préside, et qui œuvre à l’union, hors parti, de tous les antiremplacistes, c’est-à-dire de tous ceux qui sont convaincus que la seule question vraiment vitale est celle du Grand Remplacement, du changement de peuple et de civilisation, de la submersion ethnique, de la colonisation précipitée de notre pays et de notre continent ; et qu’en conséquence la seule ligne de partage vraiment sérieuse, c’est celle qui sépare les remplacistes, les partisans et promoteurs de ce changement de peuple et de civilisation, et les antiremplacistes, ceux qui sont prêts à tout pour empêcher son parachèvement.
Et donc ce septième point de la profession de foi du NON, que bien entendu j’assume pleinement, est ainsi rédigé :
« Nous sommes persuadés que la France doit sortir de l’absurde haine de soi et de la repentance perpétuelle que lui impose l’idéologie remplaciste et retrouver la fierté d’une histoire parmi les plus honorables et d’une culture parmi les plus brillantes que la terre ait portées ».
Repentance, fierté, les mots sont bien là et peut-être est-ce paragraphe qui a donné à Jean-Yves Le Gallou l’idée de m’attribuer ce sujet-là ; ou bien est-ce le souvenir d’un conte pour grands enfants, Ørop, que j’ai eu l’honneur de lire devant lui, que j’attribuais à Hans Christian Andersen, et qui décrit un empire, une vaste péninsule si profondément traumatisée par les crimes survenus sur son territoire qu’elle préfère sortir de l’Histoire que continuer la sienne : ce qui survient sera dit ne pas survenir, on prétendra que rien n’arrive, même l’invasion de l’Empire. C’est, en somme, l’inverse des fameux Habits neufs de l’empereur : dans Les Habits neufs on s’accorde à voir ce qui n’existe pas, les habits de fil d’or d’un roi nu ; dans Ørop on s’entend pour ne ne pas voir ce qui crève les yeux, l’invasion et la conquête du territoire.
Je vous prie de m’excuser de faire référence à mes propres ouvrages mais, soumis à deux thèmes que je n’ai pas choisis, je suis obligé, par souci de cohérence, ne serait-ce qu’avec moi-même, de chercher au sein de ma propre réflexion, et des volumes qui la reflètent, ce qui relève du sujet proposé, et qui en traite. Ce qui en relève le plus étroitement se trouve dans un petit essai intitulé “La deuxième carrière d’Adolf Hitler”, qu’on trouve avec deux ou trois autres textes dans le recueil Le Communisme du XXIe siècle — ce titre étant emprunté à Alain Finkielkraut et désignant bien sûr l’antiracisme. Pour ma part je ne parle plus guère d’antiracisme, quoique la chose m’ait beaucoup occupé. J’aime mieux dire remplacisme, qui me semble un concept plus riche, plus critique, aussi, plus polémique, et surtout plus aisément déclinable : remplacistes, remplacés, remplaçants.
Ainsi la situation actuelle a quatre protagonistes : les remplacés récalcitrants, vous, moi, ceux qui sont prêts à mourir plutôt que de consentir au Grand Remplacement ; les remplacés consentants, que ce soit par hébétude, par aveuglement, par repentance, justement, ou bien par sincère conviction masochiste ; les remplacistes, qui sont encore le pouvoir, peu ou prou ; et les remplaçants, de plus en plus nombreux, agressifs, revendicateurs et conquérants. Mais les remplacés consentants ne font qu’un avec les remplacistes, à toutes fins utiles, et tous seront mangés par leurs remplaçants même. De sorte qu’il n’y a vraiment que deux groupes, j’y reviens : les partisans et les acteurs du changement de peuple et de civilisation d’un côté, ses adversaires résolus de l’autre. Oserais-je ajouter que cette ligne de fracture passe aujourd’hui au sein même du Front national ?
Le remplacisme est la forme achevée de l’antiracisme, son horizon indépassable, sa conséquence inévitable, son aboutissement nécessaire : ce que l’état d’urgence est au vivre ensemble, si vous voulez. Mais d’abord il est son fils. Plus précisément le remplacisme — l’idéologie qui promeut le Grand Remplacement et le remplacement de tout par tout, des hommes par les hommes, des peuples par les peuples, des êtres humains par les machines, des animaux par les choses, du vrai par le faux, de la vraie vie par son imitation à bas coût, du réel par son double inversé, le fauxel, bref, l’interchangeabilité générale — le remplacisme est le fils monstrueux de la Révolution industrielle dans sa phase tardive, post-fordienne, tayloriste, et de l’antiracisme à son stade sénile.
“La deuxième carrière d’Adolf Hitler” désigne le rôle qu’a tenu après sa mort, et de plus en plus à mesure qu’on s’éloignait des événements de la Seconde Guerre mondiale, le führer comme référence absolue et inévitable, comme terminus ad quem de toutes les phrases, butoir obligé de tous les raisonnements. La deuxième carrière d’Adolf Hitler est moins criminelle que la première, et cela d’autant plus que lui n’était plus là pour la mener personnellement ; mais elle est d’aussi graves conséquences historiques, sinon plus vastes encore. L’Europe post-hitlérienne ressemble à un patient qui a souffert d’un cancer, l’hitlérisme, en l’occurrence, et que des chirurgiens qui ne sont pas tous professionnels, je le crains, opèrent et réopèrent pour lui arracher toute métastase possible, toute trace du mal, la moindre zone suspecte ou pré-suspecte. L’ennui est que ces médecins exhaustifs, dans leur désir compréhensible d’éradiquer à jamais le mal, emportés par leur élan, ont enlevé à leur malheureux patient, aussi, toutes les fonctions vitales indispensables : il n’a plus de cerveau, plus de cœur, plus de poumons, plus de virilité, plus de bras, plus de jambes et plus le moindre élan vital. C’est un zombie, un mort-vivant, un cadavre, qui met à ne pas être tout ce qui lui reste de volonté, et n’a d’autre désir que sortir de l’histoire. C’est ainsi que l’on voit l’Europe refuser toute dépense militaire, abandonner sa défense à des États-Unis qui s’en soucient de moins en moins et, dernièrement, aller jusqu’à confier à l’un de ses principaux envahisseurs, la Turquie, à grands frais, le soin de retarder un peu l’avance des autres : ce dont bien entendu ce pays n’a cure, si encore il n’est pas, de cette avance, plus qu’un peu responsable.
Foyer de la repentance, l’antiracisme, en tant que puissance politique majeure, est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale de la fumée des camps de la mort et il tire d’eux la plus grande part de sa légitimité, érigé en arme absolue de langage par le truchement de l’incontestable “Plus jamais ça !”. Qui pourrait faire la moindre objection, en effet, à cette résolution négative ? La question est de savoir si on peut s’opposer au retour de l’histoire en sortant d’elle, en la quittant ; et, d’ailleurs, si on la quitte jamais, si on échappe à ses cauchemars, même quand on prend le parti de n’y plus figurer. Mais peut-être ce caractère cyclique est-il celui-là même du sens. Un beau et sinistre retournement, le sens ayant parcouru sa boucle complète, est que l’antiracisme, né comme je viens de la rappeler de ce qui ne s’appelait pas encore la Shoah, a donné naissance à une société, la nôtre, où en des parties de plus en plus nombreuses du territoire, les fameux territoires perdus de la République, la Shoah ne peut plus être enseignée — pas plus que l’évolutionnisme, d’ailleurs ; et d’où les juifs sont obligés de fuir, tous les ans par dizaines de milliers. Par repentance du génocide des juifs l’Europe accueille des millions de musulmans, d’où résulte un monde que les juifs sont forcés de quitter.
Un autre retournement tout aussi saisissant, mais plus satisfaisant pour l’esprit, est celui qui affecte la fameuse référence aux années trente, et aux non moins illustres heures les plus sombres, sœurs les plus ombres, devenues à la longue presque comiques — je ne parle bien entendu que du syntagme —, à force d’avoir trop servi. Cette référence a été utilisée pendant des lustres à fustiger et à confondre toute tentative de résistance à la dictature antiraciste et bientôt remplaciste qui s’installait : à peine risquait-on la moindre objection à cette croissante tyrannie, à ce communisme du XXIe siècle, et au changement de peuple qu’il entraîne, on devenait mécaniquement un intellectuel des années trente, c’est-à-dire nécessairement antisémite, d’extrême-droite, fasciste, pronazi et par définition collaborateur, bien entendu. Or, par un plaisant renversement récent, la référence aux années trente a totalement changé de camp ; et ce qu’elle sert a fustiger désormais, c’est l’aveuglement et la complaisance face au totalitarisme qui vient, l’illusion de pouvoir traiter avec lui, l’esprit munichois et la collaboration, oui, mais celle du pouvoir remplaciste et de sa presse, de la presse remplaciste et de son pouvoir, plutôt, avec le nouvel envahisseur.
Il y a bien de différences, certes, entre les deux Occupations, celle de 1940-1945 et celle d’aujourd’hui, qui menace d’ailleurs d’être encore plus grave que la précédente, car plus irréversible. Celle que nous subissons cette fois-ci n’est pas militaire, elle est démographique, et c’est pourquoi beaucoup de Français ne la reconnaissent pas pour ce qu’elle est. Elle ne se manifeste pas par des armées ennemies défilant sur les Champs-Élysées mais par des pieds sur les banquettes du RER, des sommations du regard à devoir descendre du trottoir, la tiers-mondialisation de l’espace sensible et les rafales de kalachnikov : tout ce que j’ai nommé la nocence, l’art et la manière de nuire, et que désigné justement, il m’en coûte d’interminables procès, comme l’instrument de la conquête. Mais si les deux Occupations divergent sur bien des points, les deux Collaborations, elles, se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Il ne se passe pas de jour qu’on ne croie entendre le pouvoir remplaciste citer, à un mot près, la fameuse déclaration de Pierre Laval, « Je souhaite la victoire de l’Allemagne ». Encore n’est-ce même pas toujours à un mot près, ce nom de pays, que ces discours sont semblables : car l’Allemagne, par le truchement de son actuelle chancelière, joue un rôle considérable, soit en tant que telle, soit comme puissance tutélaire de l’Europe institutionnelle, dans l’accélération actuelle du changement de peuple — annoncé d’ailleurs, faut-il le rappeler, par un Allemand, Bertolt Brecht :
« Ne serait-il pas possible pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d’en élire un autre ? ».
Changer de peuple, dissoudre le premier par la destruction systématique de toutes ses structures, famille, citoyenneté, espace, paysage, langage, culture, et par l’enseignement de l’oubli, n’est-ce pas exactement ce que met en œuvre l’Europe telle que la pilote la chancelière allemande ? N’est-ce pas l’Allemagne — non pas celle que nous admirons et qui nous inspire, celle de Pegida, mais l’Allemagne institutionnelle — qui s’enthousiasme à l’idée d’accueillir des millions d’immigrés, et qui prétend ensuite les répartir dans tous les pays d’Europe, le nôtre éminemment compris, sur le modèle de la trop fameuse “politique de peuplement” de Manuel Valls, laquelle a au moins le mérite de la franchise, même si elle semble oublier, dans sa distraction, qu’en France il y a, ou il y avait, déjà un peuple. Tout juste pourrait-on dire que jadis l’Allemagne se donnait au moins la peine de nous envahir elle-même. Aujourd’hui elle sous-traite. Mais le résultat risque d’être encore pis.
C’est cela aussi, la deuxième carrière d’Adolphe Hitler, sa carrière inversée, arc-boutée sur l’horreur qu’inspire la première. Le racisme a échoué de très peu, en 1945, à détruire la civilisation européenne ; l’antiracisme, en 2016, paraît encore plus près d’y parvenir. Aussi bien racisme et antiracisme ont-ils beaucoup en commun, ne serait-ce que la même acception ridicule, pseudo-scientifique et incroyablement limitée, du mot race : la même qui permet au racisme d’entreprendre l’éradication d’une ou deux races qui ne sont pas à son gré, et à l’antiracisme de les effacer toutes, en soutenant qu’elles n’existent pas. Ceux qui prétendent que les races n’existent pas sont peut-être de grands biologistes, et encore, je n’en mettrais pas ma main au feu ; mais de toute évidence ce sont de très mauvais linguistes. Ils ne savent pas ce que c’est qu’un mot — ce qui les rend d’autant plus imprudents de s’attaquer à l’un des mieux inscrits de notre langue, de notre poésie et notre littérature, en cinquante acceptions diverses : famille, lignée, dynastie (les rois de la troisième race), type humain (la race des avaricieux, la race des héros), catégories de praticiens d’un art, d’un plaisir, d’un vice ou d’un métier (race des peintres du dimanche, des canotiers, des fumeurs de pipes, des dentistes et celle, trois fois maudite, des plombiers qui ne viennent jamais). Et je ne dis rien de nos amies les bêtes, chiens, chats chevaux, auxquels personne n’a eu le courage de signifier jusqu’à présent qu’il n’y avait pas de races parmi elles.
Dire qu’il n’y a pas de races, à la vérité, c’est aussi bête que de dire qu’il n’y a pas de mythes, ou pas de classes sociales. Et l’on ne s’étonnera pas dans ces conditions que les gens n’aient jamais tant parlé à partir de la leur, et chanté dans leur arbre généalogique, que depuis l’invention française de leur inexistence, il y a un petit demi-siècle.
Quand je prends le risque de faire référence à la race je ne fais pas référence à Vacher de Lapouge, faut-il le dire, à Rosenberg ou à Chamberlain, que je ne n’ai pas lus et qui ne m’inspirent guère de curiosité ; mais à Malherbe (Que direz-vous, races futures, / Si quelquefois un vrai discours / Vous récite les aventures / De nos abominables jours ?), à Pascal (Les Suissses s’offensent d’être gentilshommes et prouvent leur roture de race pour être jugés dignes des grands emplois), à Racine (Aux portes de Trézène et parmi les tombeaux / Des Princes de ma race, illustres sépultures… ) ; et moins à Gobineau qu’à Bernanos, qui en a donné je crois la plus belle image :
« Hélas, autour des petits garçons français penchés sur leurs cahiers, la plume à la main, attentifs et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleurs, au bras d’une jeune fille blonde, il y avait jadis ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens. »
Ma référence n’est pas le moins du monde innommable, elle est le général de Gaulle, que je ne vous ferai pas l’offense de citer devant vous une fois de plus sur ce point ( «Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche… etc. » ) et même Georges Pompidou que j’aurais pu entendre déclarer à Sciences-Po :
« Le choc de la défaite, l’extraordinaire aventure du général de Gaulle, et sans doute une réaction en profondeur de notre race… »
Et quelques lignes plus bas, dans le même discours pour le centième anniversaire de la rue Saint-Guillaume :
« Le second obstacle est sans doute le plus rude. Il tient, nous ne le savons que trop, au caractère même de notre race, à cette versatilité que César discernait et utilisait déjà contre les Gaulois… etc. »
Nous sommes en 1973. C’est sans doute une des toutes dernières fois qu’un président de la République va parler aux Français de leur race, car nous sommes juste à l’orée de la dictature antiraciste, qui va s’abattre comme une effroyable chape sur la langue et sur la pensée, et jouer le rôle capital qu’on sait dans le processus d’imbécilisation et dans l’industrie de l’hébétude. J’ai fait remonter aux camps de la mort et à l’incriticable plus jamais ça la légitimité qui donne à la tyrannie son pouvoir, et lui fournit ses armes absolues de langage ; mais il faut remarquer qu’entre la première et la deuxième carrière d’Adolf Hitler il y eut une période de latence d’une trentaine d’années environ. L’effet paralysant sur la vie de l’esprit n’a commencé à se manifester en France qu’en les dernières décennies du XXe siècle.
Je crois, pour ma part, deux choses : d’abord que la race, non pas la chose, qui n’existe pas, mais le mot, est indispensable à la défense de l’identité, autant dire à la défense de l’indépendance et de la liberté : ce terme est l’un de ces éléments vitaux dont je parlais il y a un instant, et que des chirurgiens fous ont arraché par fureur d’exhaustivité, et par ubris de la prudence, au corps pantelant de l’Europe ; et deuxièmement que l’antiracisme est au mieux inutile, au pire une perversion de l’esprit : tout ce qu’il y a en lui de précieux, et c’est beaucoup, se trouve déjà dans la morale, en effet ; le reste est gros de cette monstruosité éthique, le remplacisme, cette fabrique de l’homme remplaçable. Pourtant son hégémonie idéologique a été avalisée dans notre pays par François Mitterrand qui, voyant le socialisme décidément impossible, le remplace par l’antiracisme comme religion d’État, de même que ses successeurs remplaceront leur électorat populaire, qui les a quittés, par l’électorat des quartiers populaires, comme on dit pour désigner ceux dont notre peuple a été chassé, dans la langue du faux, celle que j’ai appelée le fauxel, et qui sert à assurer que ce qui survient ne sera pas nommé.
Du changement d’électorat au changement de peuple il y a si peu qu’on ne sait pas lequel a précédé l’autre. Il s’agit toujours de remplacer. Et en chacune de ces substitutions le remplacisme s’affirme pour ce qu’il est, un tout, une idéologie totalitaire, née de la bienheureuse convergence d’intérêts entre antiracisme de gauche, d’une part, devenu stratégie électorale et plan de carrière, et d’autre part financiarisme de droite, lui-même dénationalisé, désoriginé, dénaturalisé et même dénaturé, et qui a tout à gagner à la conception d’un homme lui-même désoriginé, déshistoricisé, déculturé et si possible hébété, interchangeable à volonté, comme un produit dûment normalisé. L’opposition gauche droite subsiste, mais comme une opposition secondaire par rapport à la seule ligne de fracture qui compte vraiment, j’y reviens, celle qui oppose remplacistes et antiremplacistes.
La Némésis du remplacisme c’est qu’il remplace un peuple soigneusement préparé par ses soins au Grand Remplacement par un peuple de farouches identitaires ; un peuple de veaux industriels, si l’on veut, par un peuple de loups affamés. Ce faisant, il creuse son tombeau. En attendant, entre les deux totalitarismes qui se partagent l’espace occidental, le remplacisme et l’islamisme, c’est pacte germano-soviétique permanent — disons plutôt germano-turc.
Entre-temps la repentance, à partir du foyer central brûlant des camps de la mort, où elle a très inégalement lieu d’être suivant les nations (on voit mal en quoi la Grande-Bretagne est concernée, par exemple), s’est élargie à toute l’histoire occidentale et à toute celle, car c’est bien de cela qu’il s’agit, même si le mot ne doit pas être prononcé, de notre race. Le blanc est l’homme coupable de la Terre. Et bien loin de moi de vouloir en rien réduire ses torts ni ses crimes quant à la colonisation et l’esclavage qui sont, avec la Shoah, mais en général pas par les mêmes accusateurs, les principaux reproches qui lui sont faits, non sans assimilation rhétorique, au passage, avec crime contre l’humanité et génocide. Tout juste se permettra-on de souligner le paradoxe d’un génocide, la colonisation, qui, en deux ou trois siècles, a multiplié par dix ou vingt les populations concernées ; et c’est d’ailleurs, cette contribution à la surpopulation, un autre reproche qu’on pourrait faire à l’homme blanc, d’un point de vue cette fois purement écologique. La forme extrême et presque comique du paradoxe, emblématique en tout cas, c’est l’habitude du président algérien Azziz Bouteflika, grand praticien du recours polémique et rémunérateur au terme de génocide, pour parler de la colonisation de l’Algérie, de se précipiter en France au moindre bobo, afin de se faire soigner dans nos hôpitaux, aux frais de la République je crois bien — ce serait un peu, si l’on prenait un instant au sérieux ses discours, comme si les Israéliens n’avaient confiance qu’en la médecine allemande en Allemagne, ou comme si la famille d’Anne Frank avait fait dix fois le voyage du Brésil pour recevoir les soins du docteur Mengele.
Il faut que les colonisateurs n’aient pas laissé si mauvais souvenir à leurs colonisés pour que ceux-ci, à peine débarrassés de ceux-là, n’aient d’autre idée que de se précipiter chez eux pour continuer à jouir de leur compagnie et de leur administration — à moins qu’ils ne viennent en conquérants à leur tour, ce dont il ne serait pas mauvais, si c’est bien le cas, comme je le crois, de s’aviser.
Quant à l’esclavage il n’est pas question non plus, bien entendu, d’en diminuer ou même d’en relativiser l’horreur, pour ses victimes. Mais puisque nous en sommes aux paradoxes et retournements on notera celui-ci, que les descendants des esclaves ont depuis plusieurs générations, aux États-Unis, aux Antilles — exception faite pour Haïti, trop vite indépendante — un sort mille fois plus enviable que leurs frères de race qui n’en comptent pas parmi leurs ancêtres, et qui semblent n’avoir désir plus ardent que de venir s’agréger, par-delà les mers, à cette aristocratie de privilégiés. Si les descendants des millions d’esclaves rendus tels par les musulmans n’inspirent pas de pareille envie c’est qu’ils n’y en a pas, et pour cause : les maîtres ont veillé de façon un peu radicale, de ce côté-là du monde, à ce que leur population servile ne se reproduise pas.
Tout ce que je viens de dire est éminemment discutable, il va sans dire, contestable, nuançable surtout. Or, le contestant, le corrigeant, l’euphémisant, le retournant et retournant encore, on serait au cœur de la tradition intellectuelle et même spirituelle de notre civilisation. Racines chrétiennes, certes, juives, gréco-latines, celtes, et j’en passe. Mais, liée à elles et d’ailleurs jaillie de certaines d’entre elles, cette tradition tout aussi vive de notre race, comme dirait Georges Pompidou — cependant, ici, je songe moins à la France qu’à l’ensemble de l’Europe —, j’ai nommé l’esprit de libre examen, et d’abord de soi-même. Dérivé sans doute de la foi en le péché originel, et donc de la conviction que la nocence précède l’in-nocence, ainsi que le montre assez la configuration des mots, il y a dans le génie des peuples européens une tendance non seulement à l’introspection mais au remords, à la correction, au pentimento, à la honte.
J’ai écrit jadis un “Éloge de la honte”, et je m’y tiens. La honte, ou si l’on veut la paranoïa, le doute, le scrupule, la conviction qu’on n’est pas toujours assez bon pour l’autre et pour soi-même, sont au fondement de la civilisation, et en tout cas de la nôtre. Les êtres sans paranoïa sont des rhinocéros. Les individus qui ne connaissent pas la honte, qui sont insensibles à l’opinion qu’eux-mêmes et les autres peuvent bien nourrir de leurs actions, les êtres sans vergogne, disaient nos aïeux, ceux-là sont des brutes, des nocents permanents, une racaille inassimilable aux exigences de la cité. Joseph Needham, le grand historien de la science chinoise, que cite Jacques Dewitte dans son essai L’Exception européenne, demande pourquoi c’est l’Occident qui a créé la science. Et de répondre : parce qu’il connaissait la honte. « L’essence même de la démarche scientifique est en effet de se mettre sans cesse en question, de chercher à se prendre soi-même en défaut » dit François Lurçat, le physicien, dans son livre au titre et sous-titre significatifs, La Science suicidaire, Athènes sans Jérusalem. Mais ces réflexions valent aussi bien pour la littérature occidentale, et sans doute pour la philosophie. Commencer à écrire, pour un Européen, c’est corriger une phrase qui précède et qui, elle, n’a jamais été écrite. Tout art est pentimento. Toute constitution est remords. Nous sommes la civilisation chassée du Paradis terrestre, et qui se souvient des dieux. La perte, Rilke l’a souligné, voilà ce qui fonde notre possession. La honte, écrivais-je dans son éloge que j’ai dit, est le revers de l’honneur : sans la sanction toujours à craindre du déshonneur, il n’y a pas d’honneur possible. Cependant il est grand temps de renverser ce postulat, ou plutôt de lui faire effectuer, à lui aussi, un tour supplémentaire dans la spirale du sens. En situation de grave menace pour l’existence même de notre patrie et de notre civilisation, ce n’est pas sur le sentiment de culpabilité et sur la repentance qu’il faut bâtir notre fierté et notre désir de libération du joug colonial. Il faut remonter plus haut. Si nous sommes travaillés à l’excès par la repentance, c’est d’abord que nous avons été hantés par la pensée. En cette banlieue de l’être où nous sommes réduits par l’aliénation, par la chosification du vivant, par l’hébétude, par le remplacisme global et pour-toussiste, c’est sur la vie de l’esprit, sur la culture, sur la connaissance, sur la science, sur la spiritualité, sur l’interrogation perpétuelle de nous-même et de l’autre, sans haine de soi ni haine de lui, en leur érigeant de toute part des sanctuaires — et ce colloque en est un —, qu’il faut reconstruire notre honneur, c’est-à-dire notre identité : elle est passion de la liberté, irremplaçable.
Renaud Camus