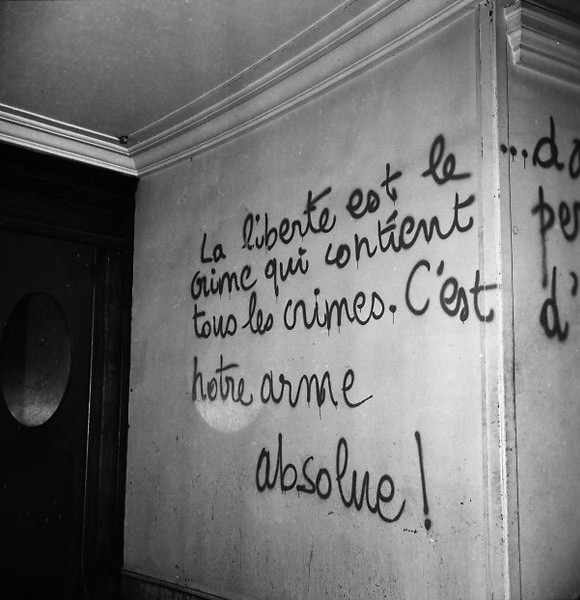Il y a aujourd’hui 50 ans jour pour jour que le clown trublion Daniel Cohn-Bendit lançait à Nanterre son « Mouvement du 22 mars » à partir d’une revendication de potaches : obtenir, dans les résidences universitaires, la libre circulation entre les bâtiments des filles et ceux des garçons !
Six semaines plus tard, la France entrait dans la « chienlit » !
Au moment où la classe dirigeante se prépare à célébrer − comme on peut l’imaginer − le cinquantenaire de Mai 68, il nous a semblé utile d’anticiper les fadaises convenues qui vont nous être assénées à longueur d’antenne, et de témoigner, pour les jeunes générations, de ce que furent vraiment les racines du mal qui ronge aujourd’hui la France.
Le court texte ci-dessous, signé de Luc Kerog, est paru sur le site ami Volontaires pour la France.
Nous le reproduisons avec plaisir et incitons tous nos amis lecteurs à le diffuser abondamment et par tous les moyens…
Car vous êtes tous, ici, les premiers acteurs de la réinformation !
MLS
 Je célèbrerais volontiers Mai 68, s’il était avéré que la charge héroïque des étudiants parisiens contre les SS – c’est ainsi que l’on désignait à l’époque les CRS – avait été menée contre une dictature sanguinaire qui brimait la population, pourchassait et emprisonnait les opposants, si le chef de l’état, le général de Gaulle, avait ressemblé à Hitler ou à Mussolini. Et surtout, s’il y avait eu des morts dans les rues de Paris. Il n’y en a pas eu. Sans cela, je célèbrerais volontiers l’événement.
Je célèbrerais volontiers Mai 68, s’il était avéré que la charge héroïque des étudiants parisiens contre les SS – c’est ainsi que l’on désignait à l’époque les CRS – avait été menée contre une dictature sanguinaire qui brimait la population, pourchassait et emprisonnait les opposants, si le chef de l’état, le général de Gaulle, avait ressemblé à Hitler ou à Mussolini. Et surtout, s’il y avait eu des morts dans les rues de Paris. Il n’y en a pas eu. Sans cela, je célèbrerais volontiers l’événement.
À moins que des choses m’aient échappé – j’avais dix sept ans au moment des faits et je n’ai pas trop prêté attention – la société devait, sans aucun doute, être bien cruelle. D’après ce que l’on nous disait. Il paraît que tout nous était interdit. Il est vrai que nos maîtres d’école nous imposaient des savoirs sans qu’il nous soit permis de donner notre avis sur le contenu des programmes. Dans les pensionnats, nous devions nous taire dans les salles d’études, les couloirs, les dortoirs. Lors des promenades du jeudi, nous étions obligés de marcher trois par trois, forcés de nous tenir correctement, de nous écarter sur le trottoir pour laisser passer les vieilles dames, de nous taire et baisser la tête au passage d’un corbillard. Pire encore, nous étions quarante par classe ! Avec interdiction de nous déplacer sans l’autorisation du professeur devant lequel – par-dessus le marché – nous devions nous lever lorsqu’il entrait en classe. Si encore l’Éducation Nationale nous avait mis au centre du projet éducatif, comme on s’applique à le faire aujourd’hui. Même pas !
Nous vivions sans doute une scolarité tyrannique, mais, encore un fois, j’étais trop jeune pour m’en rendre compte. Ce n’est que plus tard, grâce aux études approfondies de philosophes, de sociologues, de psychologues, de pédagogues, d’experts, de spécialistes, que j’ai appris qu’à cette époque, nous étions malheureux.
Il est un peu vrai qu’à la maison nos lectures étaient surveillées.
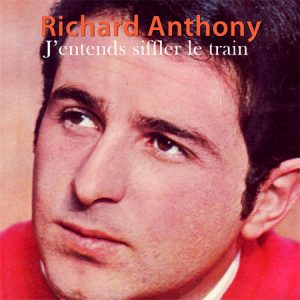 La « Bibliothèque Verte » était recommandée aux garçons et les « Éditions Rouge et Or » conseillées aux filles. Même si l’on pouvait y lire de très belles choses, cet accompagnement forcé à la lecture allait être jugé intolérable à ceux qui se préparaient déjà à nous libérer des carcans familiaux. Il faut reconnaître aussi que nos musiques préférées faisaient l’objet d’une même surveillance étroite. C’est à la seule condition de fermer la porte qui séparait la pièce des parents de nos chambres, et en ne mettant pas le son trop fort, que nous pouvions entendre siffler le train de Richard Antony ou cogner le marteau de Claude François. Toutes ces choses ne nous ont pas paru insupportables sur le moment et nous trouvions même un certain charme à braver les interdits ou, pour le moins, à nous en accommoder.Sans Mai 68, nous n’aurions jamais su qu’en fait nous en souffrions !
La « Bibliothèque Verte » était recommandée aux garçons et les « Éditions Rouge et Or » conseillées aux filles. Même si l’on pouvait y lire de très belles choses, cet accompagnement forcé à la lecture allait être jugé intolérable à ceux qui se préparaient déjà à nous libérer des carcans familiaux. Il faut reconnaître aussi que nos musiques préférées faisaient l’objet d’une même surveillance étroite. C’est à la seule condition de fermer la porte qui séparait la pièce des parents de nos chambres, et en ne mettant pas le son trop fort, que nous pouvions entendre siffler le train de Richard Antony ou cogner le marteau de Claude François. Toutes ces choses ne nous ont pas paru insupportables sur le moment et nous trouvions même un certain charme à braver les interdits ou, pour le moins, à nous en accommoder.Sans Mai 68, nous n’aurions jamais su qu’en fait nous en souffrions !
Nous étions habillés, sensiblement, tous pareils. Les parents s’en tenaient à l’aspect pratique des vêtements, à un assortiment intelligent des couleurs et, par souci d’économie, à leur résistance aux assauts du temps. La partie du corps qui était le signe le plus visible de l’ordre bourgeois – à ce qu’il paraît – c’était les cheveux dont la longueur donnait une idée précise du stade d’émancipation de l’individu. Même si certains gagnaient à les avoir courts et d’autres s’enlaidissaient à les laisser pousser. Mais, en mai 68, l’esthétique n’avait pas grande importance aux yeux de ceux qui voulaient faire la révolution.
Toujours du haut de mes dix-sept ans, je me souviens aussi qu’au mois de mai et de juin de cette année-là il avait fait très beau. Ce qui avait fait dire à un observateur un brin rabat-joie – un affreux réactionnaire sans doute – que, s’il y avait eu de la pluie, la révolution aurait fini plus tôt. À l’âge que j’avais à l’époque, je n’ai retenu des événements de Mai 68 que ces petites choses de la vie de tous les jours. Ce n’est que des années plus tard que j’ai su que cette révolution n’en a jamais été une. Au sens noble du terme… Du moins si l’on peut présenter les choses ainsi.
(À suivre)
Luc Kerog
VPF 56
22/03/2018
Article publié par Volontaires Pour la France