
« Les combattants de DBP sont morts parce que nous nous sommes menti à nous- mêmes. Ils sont morts parce que nous n’avons pas su faire correctement cette guerre, parce que nous n’avons su ni la vouloir ni la refuser … »
(Pierre Brisson ; « le Figaro », 9 mai 1954).
« Nous pouvons désormais agir sur un terrain propre, sans la moindre tache de colonialisme. Diên-Biên-Phu a été un bienfait caché … »
(Foster Dulles, porte-parole du gouvernement des USA en novembre 1954).
![]()
En ce 7 mai 2024, soixante-dixième anniversaire de la défaite de Diên-Biên-Phu, il me revient en mémoire un souvenir vieux de plus de quarante ans. Chaque année, et ce depuis des années, le 7 mai, j’écris un article pour rendre hommage à nos combattants de Diên-Biên-Phu. Quand, en 1968 ou 69, j’ai connu le  général Langlais qui commandait le GAP 2 (1) (et qui avait sous ses ordres mon père, capitaine à l’époque) je me suis passionné pour cette bataille. J’ai sans doute lu une cinquantaine de livres sur le sujet et je me suis dit qu’un jour, moi aussi j’écrirais un livre sur DBP, par « devoir de mémoire » envers une garnison héroïque, sacrifiée inutilement par un pays qui voulait sortir le plus dignement possible du bourbier indochinois. Ce livre a vu le jour en 2011, peu de temps après mon départ en retraite ; il s’intitule « Au capitaine de Diên-Biên-Phu » (2).
général Langlais qui commandait le GAP 2 (1) (et qui avait sous ses ordres mon père, capitaine à l’époque) je me suis passionné pour cette bataille. J’ai sans doute lu une cinquantaine de livres sur le sujet et je me suis dit qu’un jour, moi aussi j’écrirais un livre sur DBP, par « devoir de mémoire » envers une garnison héroïque, sacrifiée inutilement par un pays qui voulait sortir le plus dignement possible du bourbier indochinois. Ce livre a vu le jour en 2011, peu de temps après mon départ en retraite ; il s’intitule « Au capitaine de Diên-Biên-Phu » (2).
J’ai eu la chance – le privilège, car c’en est un ! – de connaître plusieurs anciens combattants de cette bataille, allant du simple soldat de deuxième classe au général (Langlais qui était lieutenant-colonel au début des combats, colonel à la fin). Ce qui m’a frappé, c’est leur refus d’évoquer leurs cinquante-six jours de combat. En revanche, ils n’hésitaient pas à raconter une anecdote amusante. Je crois que c’est à Boris Vian qu’on doit la citation : « L’humour est la politesse du désespoir » ?
En ce qui concerne les anciens de DBP (Diên-Biên-Phu) , c’est sans doute vrai !
Mais venons-en au souvenir évoqué plus haut. Dans les années 80, chaque 7 mai, je recevais un appel téléphonique du responsable de l’agence de Nice de la société d’assurance pour laquelle je travaillais. Sa voix était chargée d’émotion, elle bafouillait un peu, le phrasé était hésitant, saccadé. Mon interlocuteur était saoul comme un Polonais, il avait besoin de parler et… je savais pourquoi.
Cet homme était sergent au 6ème Bataillon de Parachutistes Coloniaux – le fameux « Bataillon Bigeard » – lors de l’ « opération Castor » sur la cuvette de Diên-Biên-Phu en novembre 1953. Arrivé en fin de séjour, il avait regagné la métropole avant l’offensive que 13 mars 1954. Beaucoup de ses frères d’arme, ses camarades parachutistes, étaient morts durant la bataille ou au cours de la longue marche vers les camps-mouroirs du Vietminh. Il avait terminé une belle carrière avec le grade d’adjudant-chef, médaillé militaire et chevalier de la légion d’honneur (2), peu après la fin de l’Algérie française. Et depuis la chute de Diên-Biên-Phu, chaque année, en bon « para-colo », il prenait une cuite mémorable ; c’était sa façon à lui de rendre hommage aux soldats français, aux Légionnaires, aux supplétifs, tombés dans cette sinistre cuvette. Certains boivent pour oublier ; lui, il buvait pour ne pas oublier. Quand je décrochais, il me demandait avec une voix pâteuse : « Vous savez pourquoi je vous téléphone ? » Je répondais « Oui » et il ajoutait aussitôt « Votre père était là-bas ». Puis il énumérait ses camarades morts au combat. Chez lui, pas d’envolées larmoyantes. Au 6ème BPC, il avait appris que « chez Bigeard on meurt rasé » et que « les grandes douleurs sont muettes ». Il avait envie de parler à quelqu’un qui avait porté le béret rouge et qui connaissait (un peu) le sujet.
Un 7 mai, dans l’après-midi, le patron de la branche « automobile » était venu me voir et m’avait déclaré, furieux : « Ce type est un poivrot, un ivrogne ; je l’ai appelé pour un dossier. Il bafouillait, visiblement il était complètement bourré ». Et je lui avais répondu sèchement : « Le 7 mai, il a le droit de boire, même de boire beaucoup et de se saouler. Foutez-lui la paix, vous ne pouvez pas comprendre ! ». Non, il ne pouvait pas comprendre que tous les 30 avril, la Légion Étrangère fête le combat de Camerone (30 avril 1863) ; tous les 1ers septembres, les « Coloniaux » – Marsouins et Bigors – honorent leurs morts de la bataille de Bazeilles (31 août-1er septembre 1870).
Il s’agit pourtant de deux défaites de nos armes, mais elles résonnent dans leurs cœurs comme des victoires tant elles magnifient le patriotisme, le don de soi, le courage, le sens du devoir, de la fidélité et de l’Honneur, avec un grand « H ».
Je n’ai jamais risqué ma peau sur un champ de bataille, pourtant, chaque 7 mai, j’ai une pensée pour un village thaï situé dans un coin perdu du haut-Tonkin qui, du 13 mars au 7 mai 1954, a vu une garnison française se battre héroïquement – à un contre trois, puis à un contre dix – contre les troupes communistes du Vietminh. Je considère la bataille de Diên-Biên-Phu comme le Camerone des Parachutistes (même si je n’oublie pas tous les autres : cavaliers, artilleurs, tirailleurs algériens, légionnaires, aviateurs, pilotes de l’Aéronavale, supplétifs indigènes…etc…).
Au début de mon livre « Au capitaine de Diên-Biên-Phu », j’écris ceci :
« De 1946 à 1954, notre Corps Expéditionnaire d’Extrême-Orient a mené des combats héroïques avec des moyens limités : une guerre de pauvres, une guerre de gueux. Nos paras, en treillis dépareillés, avec un armement souvent disparate et vétuste, « félins et manœuvriers » comme l’exigeait Bigeard, se sont remarquablement battus… Ce conflit, achevé avec la défaite de Diên-Biên-Phu, nous a coûté entre 70 000 et 80 000 tués (4), trois fois plus que la guerre d’Algérie. Or, en dehors de trop rares auteurs, personne en France n’ose évoquer cette belle page de notre histoire. Nous ne devrions pourtant en ressentir aucune « repentance » mais une fierté ô combien légitime ! … »
Le « Roi Jean » de Lattre de Tassigny n’a-t-il pas dit, le 11 juillet 1951 :
« D’entreprise aussi désintéressée que cette guerre, il n’y en avait pas eu, pour la France, depuis les croisades ».
Mon vieil adjudant-chef est mort depuis longtemps, comme mon père, comme le général Pierre Langlais, comme « Bruno » Bigeard, et tant d’autres. Un à un, les anciens d’Indochine, les survivants de l’enfer, quittent la scène, discrètement, sans bruit et sans laisser de trace dans les manuels d’histoire. De leur vivant ils étaient assez peu loquaces sur Diên-Biên-Phu. Trop de morts, trop de sang, trop de souffrance. Leur mémoire, volontairement sélective, n’a voulu conserver que les bons moments de leur carrière. Les mauvais resurgissent aussi, parfois, les soirs de cafard, quand un ami disparaît. Il reste encore une poignée d’anciens de Diên-Biên-Phu. Quand ils auront disparu, qui reprendra le flambeau pour qu’on se souvienne de leurs combats ? Pas grand monde, je le crains, dans notre pays décadent, repentant, et qui a honte de son passé colonial.
La guerre d’Indochine a tué sept promotions de Saint-Cyriens. La génération de mon père a commencé la guerre – que l’on disait « drôle » à l’époque – en 1939. Elle a déposé les armes en 1962, après les funestes Accords d’Evian et l’indépendance de l’Algérie. Ces hommes ont été marqués par la mort, ils ont « flirté » avec elle. La camarde en a pris beaucoup, elle en a épargné d’autres qu’elle a laissé « K.O. debout », sans doute pour qu’ils témoignent, mais finalement, très peu ont accepté de témoigner. Par modestie, par pudeur, par respect pour leurs morts, ils ont préféré se taire.
Presque tous les combattants de Diên-Biên-Phu – officiers, sous-officiers et hommes du rang – ont choisi, délibérément pour la plupart, d’être des oubliés de l’histoire.
En 1992, la sortie du film « Diên-Biên-Phu » de Pierre Schoendoerffer avait suscité chez eux des réactions étranges : indifférence, mécontentement, irritation, indignation parfois.
Schoendoerffer, qui a vécu la bataille comme cinéaste aux armées, a cru utile de témoigner, et, malgré les critiques, je persiste à penser qu’il a eu raison. Les Américains ont produit « Apocalypse Now », « Platoon » et quelques autres films à la gloire de la puissante Amérique (5), pour raconter, magnifier, enjoliver, une guerre perdue malgré des moyens matériels et logistiques énormes. Avec le temps, l’Amérique a exorcisé sa guerre au Vietnam. À coups de films de propagande à gros budget, elle a tiré un trait sur ses bombardements à l’aveugle sur des populations civiles, son napalm, son défoliant (le fameux « agent orange » qui continue encore aujourd’hui à faire des victimes). Elle refuse de reconnaître que, pendant vingt ans, le pire ennemi de ses « boys » n’était pas le Viet mais la drogue, la crasse, l’indiscipline et les maladies vénériennes attrapées dans les bordels de Saïgon.
En « Indo » – notre Vietnam – la France a mené une guerre de gueux pour une cause juste. C’est une bonne chose qu’on en parle, qu’on mette à profit les soixante-dix ans de la chute de Diên-Biên-Phu pour en parler enfin ! Le bilan de la bataille de Diên-Biên-Phu est édifiant : du côté français (hors supplétifs), nous avons perdu 7184 hommes (4436 blessés).
Parmi ces pertes : 214 officiers et 840 sous-officiers. Le général Giap, qui a tendance à minorer les pertes de son « Armée populaire » déclarait à Jules Roy que nos troupes lui avaient infligé 30 000 morts. La réalité doit être du double sinon du triple !
A Diên-Biên-Phu, durant les cinquante-six jours de combat, la densité d’obus au mètre carré a été deux fois supérieure à celle des pires heures de la bataille de Verdun, et dans la cuvette, il n’y avait pas de « voie sacrée » pour envoyer des renforts ou pour évacuer les blessés.
Le 7 mai 1954, faute de munitions, la garnison de Diên-Biên-Phu déposait les armes, sans se rendre, sans drapeau blanc. Le lieutenant Jacques Allaire, du 6ème BPC, exigea même une note écrite de Bigeard avant d’accepter de déposer les armes.
 Ensuite, les prisonniers de Diên-Biên-Phu allaient connaître l’enfer : une longue marche de plus de 700 kilomètres vers les camps-mouroirs viets. 11 721 hommes ont été capturés à Diên-Biên-Phu. Quelques mois plus tard, le Vietminh en rendait… 3290 dont beaucoup à l’état de cadavre.
Ensuite, les prisonniers de Diên-Biên-Phu allaient connaître l’enfer : une longue marche de plus de 700 kilomètres vers les camps-mouroirs viets. 11 721 hommes ont été capturés à Diên-Biên-Phu. Quelques mois plus tard, le Vietminh en rendait… 3290 dont beaucoup à l’état de cadavre.
Mon père est rentré de captivité pesant… 39 kilos.
8431 soldats français sont morts en captivité (durant la longue marche ou dans les camps).
C’est, toutes proportions gardées, un taux de mortalité très supérieur à celui des camps de concentration allemands. À leur retour en métropole, nos soldats n’ont eu droit qu’aux insultes du quotidien communiste « l’Humanité » et à l’indifférence voire le mépris des civils. Pas de « cellules de soutien psychologique », pas d’articles dans la presse pour vanter leur sacrifice, leur courage, leur héroïsme. Pas (ou peu) de reconnaissance d’une nation qui voulait oublier l’Indochine.
Pourquoi n’apprend-t-on pas aux petits Français, qu’en 1954, dans un coin perdu d’Extrême-Orient, à 10 000 kilomètres de la mère-patrie, quelques braves livrèrent un dernier combat héroïque, un baroud d’honneur, pour la défense de nos valeurs : celles de l’Occident chrétien.
Contraints d’abandonner leurs supplétifs et leurs familles en quittant l’Indochine, beaucoup d’entre eux franchiront le Rubicon, le 21 avril 1961, pour ne pas livrer les populations musulmanes amies aux égorgeurs du FLN et tenter de sauver l’Algérie française. Mais ceci est une autre histoire : une histoire qu’il faudrait aussi enseigner à nos enfants, honnêtement, sans passions partisanes, pour qu’ils arrêtent cette culpabilisation idiote et injuste qu’on appelle « repentance » et qu’ils soient fiers du passé de leur pays.
Éric de Verdelhan
07/05/2024
1) GAP 2 : Groupement Aéroporté (à l’époque on écrivait Aéro-Porté) N°2.
2) « Au capitaine de Diên-Biên-Phu » publié en 2011 ; chez SRE-éditions ou sur Amazon.
3) Ce qui est relativement rare chez les sous-officiers. En France on distribue la légion d’honneur à des saltimbanques mais on la donne rarement à des sous-officiers souvent remarquables.
4) Sans compter les Légionnaires et les supplétifs indigènes.
5) Et ne parlons pas des pseudos exploits ridicules de « Rambo 1, 2 , 3 … »


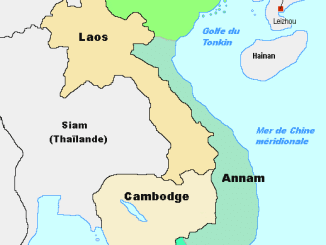


Et votre article paraît, Monsieur de VERDELHAN, juste le jour où Geneviève de GALARD, surnommée l’Ange de Dien Bien Phu , vient de rendre son âme à Dieu. Saluons respectueusement cette femme courageuse qui soignait et aidait nos soldats avec des moyens aussi rudimentaires que ceux qui allaient au combat.
Merci, Monsieur. Mon ex beau père a servi en Indochine sous le commandement du général Bigeard. J’ai quelques mots de lui, dans son livre, que je garde précieusement. Mer de tout mon cœur pour vos articles si passionnants.