« Dans l’histoire des poches sur le littoral français, il y a une originalité royannaise, comme il y a une originalité rochelaise…Autant La Rochelle est l’exemple de la diplomatie, des accommodements et de la recherche d’un règlement du conflit en voie d’achèvement, autant Royan est l’exemple du baroud d’honneur, de la fureur guerrière poussée à son paroxysme, du déchaînement de la violence et du combat coûte que coûte. »
(Rémy Desquesnes (1)).
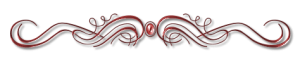
La « poche de Royan » est l’une des poches qui ont subsisté sur le littoral atlantique entre le début de la libération de la France, en août 1944, et la capitulation allemande, en mai 1945. Ces poches visaient à empêcher les Alliés de s’emparer des grands ports qu’elles protégeaient. La poche de Royan et de la pointe de Grave qui bloquait l’accès maritime au port de Bordeaux, était constituée de deux parties de part et d’autre de l’estuaire de la Gironde. Au contraire des autres poches où les Alliés se contenteront d’un blocus jusqu’à la fin du conflit, la poche de Royan sera reprise par l’Armée française en avril 1945, au prix de pertes énormes et de destructions inutiles. Mais cette affaire était motivée par des raisons plus politiques que stratégiques, puisque la fin de la guerre était proche.
Verrou de l’estuaire de la Gironde (et du port de Bordeaux), la poche de Royan comprenait la presqu’île d’Arvert, le sud de l’île d’Oléron et l’estuaire de la Seudre au nord, et les rives de l’estuaire au sud. La ville de Royan, protégée par une triple ceinture de blockhaus et bunkers fortifiés, était au cœur du dispositif allemand. La défense plus lointaine était assurée par deux batteries lourdes d’une portée de 30 km : la première, située à la pointe de la Coubre ; la seconde, à proximité du fort du Verdon. Entre les deux, des batteries de moindre calibre: à la Grande Côte, au phare de Terre-Nègre à Saint-Palais-sur-Mer, au Chay, à la pointe de Suzac et à la pointe de Grave. Au total la défense de la poche était assurée par 300 canons et une forte défense anti-aérienne.
De Gaulle, qui n’a pas été prévenu par les Alliés de l’opération « Overlord » (le débarquement en Normandie) de juin 1944, veut des victoires françaises pour imposer l’idée, qui fera son chemin, de « la France libérée par elle-même ». Le 18 septembre 1944, il se rend à Saintes et rencontre les principaux chefs de la Résistance, dont le colonel Adeline, ancien responsable des FFI de Dordogne. Lors de sa visite, il se montre cassant et affiche sa volonté de voir réduites les poches tenues par les Allemands sur le littoral atlantique par des actions offensives. Il insiste sur le fait qu’on ne doit pas « se contenter de garder des prisonniers ». Il nomme, deux semaines plus tard, le colonel Adeline, commandant des opérations du secteur de la Rochelle et du secteur de Royan – pointe de Grave. Le 14 octobre 1944 sont créées les Forces Françaises de l’Ouest (FFO), dont le QG est à Cognac, dirigées par le général de Larminat, (alors sur le front avec la 1ère Armée du général de Lattre de Tassigny). Il est secondé par le général d’Anselme, l’amiral Ruë pour la marine et le général Corniglion-Molinier pour l’aviation. Le colonel Adeline commande le secteur de Royan, le colonel de Milleret, celui de la pointe de Grave et le colonel Chêne, ancien chef de maquis de la Vienne, le secteur de La Rochelle.
Comme les généraux ont une confiance très relative dans les troupes issues de la Résistance, les opérations les plus sensibles seront confiées aux troupes régulières. L’attaque principale de Royan sera menée par le 4ème Régiment de Zouaves (4ème RZ), le 6ème Bataillon Porté de Tirailleurs Nord-Africains (6ème BPTNA)(2) et les chars de la 2ème DB. Les unités FFI sont chargées des actions annexes, nécessaires mais moins décisives. Les effectifs engagés dans la bataille de Royan seront de 73 000 hommes, appuyés par l’aviation américaine. En plus des 4ème RZ et 6ème BPTNA, seront présents les « Bataillons de Marche Somali » N°14 et 15, les FFI commandés par la colonel Adeline (Armée secrète de Dordogne, « groupements Z » et « Roland », Brigade RAC) ; les FTP de Charente du « Groupement Bernard » ; les maquisards landais de Léonce Dussarrat. Pierre Sergent (3) cite la présence sur place d’un bataillon de Légion Étrangère mais je ne saurais dire lequel ? On note également de nombreux chars français, repris à l’ennemi, et regroupés au sein du 13ème Régiment de Dragons et du Bataillon « Foch », et un soutien de quelques unités de la 2ème Division Blindée sur des chars Sherman. Et, au sein de ces éléments se trouvait le plus vieux chef de char – 41 ans – de la 2ème DB qui allait donner son nom à une salle de spectacle de Royan : Jean Moncorgé, plus connu sous le nom de Jean Gabin.
Après la libération de Colmar, il débarque à la gare de Saint-Jean-d’Angély le 12 avril. Le 14 avril, l’opération est lancée avec 25 000 hommes et 200 chars. Certes le « Souffleur II », le char que commandait Jean Gabin-Moncorgé, restera à l’arrière, à Genouillé et ne combattra pas (4), mais Jean Gabin, ce magnifique acteur, mérite un hommage. Il a été un grand patriote engagé dans les « Forces Françaises Libres », alors que les milieux du cinéma et du théâtre étaient soit réfugiés aux États-Unis, soit carrément collabos, à quelques exceptions près. Fermons la parenthèse.
En face des troupes françaises, les forces allemandes étaient d’environ 5 000 hommes (dont 106 officiers). Elles disposaient d’une importante artillerie mais n’avaient pas de chars, pas d’aviation et surtout…pas d’essence. Autour de la poche de Royan, 1 229 hectares étaient minés.
Le plan de reconquête du littoral atlantique encore occupé prévoyait une offensive limitée devant se dérouler en plusieurs phases. La première étape consistait à s’emparer de Royan, la plus petite des poches, celle qui avait la plus faible garnison. Une fois Royan prise, l’état-major prévoyait de poursuivre avec un débarquement sur l’île d’Oléron, puis dans une troisième étape contre La Rochelle, puis enfin une dernière contre Saint-Nazaire. La première étape sur Royan, l’« opération Indépendance », était prévue pour la fin de l’automne 1944. Cette date sera repoussée en raison de l’offensive des Allemands dans les Ardennes de décembre 1944.
Le 10 décembre, a lieu au QG de Cognac une rencontre entre le général Royce, commandant de la « First Tactical Air Force » et le général Corniglion-Molinier pour mettre au point le futur raid aérien devant ouvrir l’opération. Le raid aérien sur Royan démarre le 5 janvier 1945 par le largage de plus de 2 000 tonnes de bombes par des centaines de bombardiers Lancaster. Ce raid détruit la ville à 95 %. Il fera plus de 500 victimes civiles et plus de 1 000 blessés. Ce carnage inutile n’empêche pas les Allemands de repousser les assauts menés par les Français, notamment sur la Seudre.
Le 25 mars 1945, le commandement des « Forces Françaises du Sud-Ouest » (FFSO) confié depuis octobre 1944 au colonel Adeline est dissous par Larminat. Il crée à sa place un « Détachement de l’Armée de l’Atlantique » (DAA) placé directement sous ses ordres. Il sera renforcé de plusieurs bataillons coloniaux qu’Eisenhower a autorisé à quitter le front du Reich pour la côte atlantique.
L’opération est rebaptisée « opération Vénérable ». Elle démarre le 15 avril 1945 par un nouveau bombardement d’aviation, suivi d’un pilonnage intensif par les croiseurs de l’amiral Rüe et enfin par un matraquage terrestre effectué par une brigade d’artillerie lourde américaine. L’offensive terrestre est menée par la Division de marche « Gironde » (23 700 hommes) du général d’Anselme (5) et la Brigade « d’Oléron » (6 700 hommes) du colonel Adeline, appuyées par les blindés de la 2ème DB et d’autres formations cuirassées (6) soit 30 400 hommes, dont un tiers de troupes musulmanes.
L’opération s’achève le 17 avril 1945, avec la reddition du contre-amiral Michahelles.
Dans la presqu’île d’Arvert, notamment au niveau de la forêt de la Coubre, les bunkers sont tenus par les marins du Bataillon « Tirpitz » qui n’ont pas l’intention de se rendre. Le 20 avril, les troupes du colonel de Milleret, soutenues par notre aviation, négocient et obtiennent la capitulation des forces allemandes de la pointe de Grave. Après Royan, le commandement lance l’ « opération Jupiter » sur l’île d’Oléron. Une journée suffit pour obtenir la reddition de la garnison le 30 avril.
L’« opération Mousquetaire » visant à attaquer la poche de La Rochelle devait suivre mais elle est annulée en raison de la signature, le 4 mai 1945, de la capitulation partielle à Lunebourg, où le grand amiral Karl Dönitz a annoncé que « la guerre européenne est terminée ».
Parlons maintenant des bilans de la bataille de Royan. Rémy Desquesnes a écrit : « Avec le recul, on peut se poser la question de savoir si on avait réellement besoin d’une telle démonstration de force sur la côte atlantique, alors qu’au même moment les Soviétiques s’emparaient, dans Berlin, de l’aéroport de Tempelhof ». Le général Leclerc a qualifié l’opération de Royan de « mascarade ». Pour lui, c’est en entrant en Allemagne que l’Armée française se couvrirait de gloire et non pas en allant « s’embourber dans les parcs à huîtres de Marennes ». Leclerc était un grand soldat ; il savait de quoi il parlait ! Et Rémy Desquesnes ajoutait : « On peut soutenir que l’opération de prestige menée tardivement sur Royan est une victoire puérile, coûteuse et inutile ». Cet avis est partagé par un certain nombre de maquisards ayant participé aux combats.
Mon vieil ami Marcel Bouyer, ancien député de Charente-Maritime, qui fut agent de liaison dans la poche de Royan, déplorait la destruction de sa ville et le nombre de victimes. Pour lui,
« la guerre était finie ; il suffisait d’attendre ».
Philippe Papon, sous-lieutenant FFI, indique que
« plus de 2 000 tonnes de bombes s’écrasèrent sur cette ville dans le but de tuer une centaine d’Allemands repliés sur quelques kilomètres en attendant l’abdication de leur pays ; personne ne comprenait rien à ce crime ».
Et il ajoute :
« l’aviation n’avait détruit aucun objectif militaire, ni amoindri en quoi que ce soit le système défensif ennemi. On reste confondu devant un tel acte qui n’avançait pas d’une journée l’heure de la victoire ».
Du côté militaire, le général de Larminat parlait avec dédain de la convention qui a permis de sauver des centaines de vies ainsi que le patrimoine urbain et portuaire de La Rochelle. Selon Howard Zinn, qui avait participé à l’opération, ces bombardements visaient des Allemands « repliés en attendant la reddition de l’Allemagne et ne représentaient plus un quelconque danger militaire. Ils sont l’occasion d’expérimenter de nouvelles armes au napalm. Ces attaques tuèrent non seulement des soldats mais aussi des civils français … » Dans son livre « La Bombe, de l’inutilité des bombardements aériens » (7) il raconte comment le bombardement fut décidé par la hiérarchie militaire pour des raisons « qui tenaient davantage à des considérations carriéristes qu’à des objectifs militaires légitimes ».
Au cours de l’« opération Vénérable », le 4ème Régiment de Zouaves a pris la plus large part dans la victoire. Le total des pertes de l’opération, pour ces quatre journées, est de 154 tués et 700 blessés. Le 4ème RZ comptera à lui seul 60 tués et 250 blessés. Il fera plus de 2 000 prisonniers et recevra une neuvième palme à la Croix de Guerre de son drapeau.
Au regard des journaux de marche, hors éléments de la 2ème DB, les unités régulières ont perdu 93 tués (soit 56 % des 167 tués devant Royan). Dans la Pointe de Grave, les troupes coloniales, ont perdu 59 tués et 148 blessés. Les différents combats se sont soldés par la mort de 364 soldats français (et 47 civils) et plus de 500 blessés, civils et militaires confondus. Du côté allemand, les pertes sont estimées à un millier de morts et autant de blessés.
Cet article me donne l’occasion de rendre hommage à deux amis disparus qui ont combattu dans la poche de Royan : Marcel Bouyer, ancien député de Charente-Maritime, cité plus haut, et Gaston Giraud, chevalier de la légion d’honneur, qui fit ses premières armes au sein de la Brigade RAC, fondateur de la section de l’« Union Nationale des Parachutistes » de Charente-Maritime (8).
Eric de Verdelhan.
31/03/2025
1) « Les poches de résistance allemandes sur le littoral français : août 1944 – mai 1945 » de Rémy Desquesnes ; éd. Ouest-France ; 2011.
2) 4ème Régiment de Zouaves sera cité deux fois à l’ordre de l’Armée, et le 6ème Bataillon Porté de Tirailleurs Nord-Africains, une fois.
3) Il en parle dans « La Revanche », second tome de son ouvrage « Les Voies de l’honneur ».
4) « Jean Moncorgé Gabin, acteur de la Libération de Royan », Patrick Glâtre ; Bonne Anse ; 2015.
5) Qui deviendra la 23ème Division d’Infanterie.
6) le 13ème Régiment de Dragons, et le Bataillon « Foch ».
7) « La bombe, de l’inutilité des bombardements aériens » d’Howard Zinn ; Lux éditeur ; 2011.
8) Section qui porte dorénavant son nom.
Sur la bataille de Royan, on peut aussi lire: « Bombardement et libération de la poche de Royan » de Marie-Anne Bouchet-Roy ; Bonne Anse ; 2005. Et, « Royan-Pointe de Grave Poches de l’Atlantique. Occupation, fortifications, libération, 1939-1945 » d’Alain Chazette et Fabien Reberac ; Histoire et Fortifications ; 2005
![]()
FAIRE UN DON ?
Minurne fonctionne depuis sa création en 2011 sans recettes publicitaires.
Si nos articles vous plaisent, vous pouvez nous aider en faisant un don de 5 €,10 € ou 20 € (ou plus, bien sûr) via Paypal.
Cliquez ci-dessous (paiement totalement sécurisé).



Soyez le premier à commenter